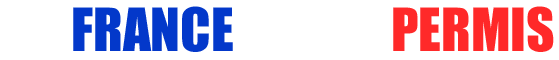Différence entre suspension administrative et suspension judiciaire du permis de conduire
En matière de droit routier, la suspension du permis de conduire peut revêtir deux formes bien distinctes : la suspension administrative et la suspension judiciaire. Ces deux types de mesures, bien qu’ayant pour conséquence commune l’interdiction temporaire de conduire, répondent à des logiques juridiques différentes, obéissent à des procédures distinctes et ont des implications spécifiques.
Connaître la différence entre ces deux suspensions permet de mieux comprendre les enjeux légaux qui entourent la sanction, d’anticiper les démarches nécessaires et de préparer une éventuelle récupération du permis de conduire.
Définition de la suspension administrative du permis de conduire
La suspension administrative du permis de conduire est une mesure préventive décidée par le préfet à l’encontre d’un conducteur, à la suite d’une infraction grave au Code de la route. Cette suspension est indépendante de toute décision de justice et intervient souvent de manière automatique après certaines infractions routières, notamment en cas :
- De conduite sous l’emprise de l’alcool (taux supérieur à 0,8 g/l dans le sang)
- De conduite sous l’influence de stupéfiants
- De grand excès de vitesse (plus de 40 km/h au-dessus de la limite autorisée)
- D’accident corporel grave avec responsabilité
Dans ces cas, les forces de l’ordre peuvent effectuer une rétention immédiate du permis pour une durée de 72 heures maximum. Durant ce délai, le préfet ou le sous-préfet peut décider de prononcer une suspension administrative dont la durée peut aller jusqu’à six mois, voire davantage (jusqu’à un an) si le conducteur est mis en cause dans un accident corporel grave.
Définition de la suspension judiciaire du permis de conduire
La suspension judiciaire est une peine prononcée par un tribunal correctionnel à l’encontre d’un conducteur reconnu coupable d’une infraction grave au Code de la route. Elle intervient à l’issue d’un procès, dans le cadre d’une procédure pénale, et est souvent accompagnée d’autres sanctions comme une amende, une inscription au casier judiciaire, ou une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis.
Les cas donnant lieu à ce type de suspension sont identiques à ceux de la suspension administrative, mais le juge conserve une marge d’appréciation et peut décider de ne pas suspendre le permis si les circonstances le justifient. La durée de la suspension judiciaire est généralement comprise entre un mois et cinq ans, mais peut être assortie d’aménagements, comme l’aménagement en suspension limitée, notamment pour les besoins professionnels.
Différences principales entre suspension administrative et judiciaire
Le tableau ci-dessous résume les principales différences.
- Autorité compétente : Préfet (suspension administrative) / Juge (suspension judiciaire)
- Nature de la mesure : Préventive (administrative) / Répressive (judiciaire)
- Délais d’application : Immédiate après une infraction (administrative) / Postérieure à une audience (judiciaire)
- Durée maximale : 6 à 12 mois (administrative) / Jusqu’à 5 ans (judiciaire)
- Recours possibles : Recours gracieux ou contentieux devant le tribunal administratif (administrative) / Appel devant la cour d’appel (judiciaire)
Suspension administrative suivie d’une suspension judiciaire : cumul ou non ?
Une question souvent posée est la suivante : Dans le cas où un conducteur a subi une suspension administrative, cette durée est-elle déduite de la suspension judiciaire qui suit ?
La réponse dépend de la décision du juge. En effet, le tribunal peut choisir de tenir compte de la suspension administrative déjà effectuée et prononcer une suspension judiciaire incluant la période déjà purgée. Cependant, ce n’est ni automatique ni obligatoire. L’avocat du conducteur devra donc plaider en ce sens pour obtenir une réduction de la peine prononcée.
Dans certains cas, la suspension judiciaire peut venir prolonger la durée d’interdiction de conduire, venant ainsi aggraver la sanction initialement prise par l’administration.
Conséquences pratiques pour le conducteur
Les deux types de suspension ont des implications immédiates sur la vie quotidienne d’un conducteur.
- Perte de mobilité personnelle et professionnelle
- Obligation de restituer son permis de conduire à la préfecture
- Possibilité d’accorder un permis blanc (rare et uniquement en cas judiciaire)
- Exigences médicales pour la récupération du permis (visite médicale, tests psychotechniques)
- Réinscription à des stages de sensibilisation à la sécurité routière
- Coûts financiers associés (amendes, frais d’avocat, tests, stages, etc.)
En cas de suspension judiciaire, les démarches sont souvent plus longues et plus complexes en raison de l’intervention de la justice. De plus, la dimension pénale laisse généralement une trace sur le casier judiciaire du conducteur (bulletin n°1 ou n°2 selon les cas).
Comment récupérer son permis de conduire après une suspension ?
La récupération du permis de conduire après une suspension, qu’elle soit administrative ou judiciaire, nécessite plusieurs étapes. Celles-ci peuvent inclure :
- Une visite médicale auprès d’un médecin agréé
- Des tests psychotechniques pour évaluer l’aptitude à la conduite
- Pour certaines infractions, la participation à un stage obligatoire de sensibilisation à la sécurité routière
- La demande de restitution du permis ou son renouvellement auprès de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés)
La loi impose ces contrôles dans le double objectif de prévention et de sécurité routière. Le conducteur qui ne se soumet pas à ces obligations ne pourra pas récupérer son titre dans les délais légaux.
Prévenir la suspension de permis : conseils pratiques
La meilleure façon d’éviter une suspension, qu’elle soit administrative ou judiciaire, reste évidemment le respect scrupuleux du Code de la route. Toutefois, il existe des démarches à envisager si vous êtes confronté à une procédure :
- Contacter un avocat spécialisé en droit routier dès la rétention du permis
- Constituer un dossier complet d’éléments favorables (motifs professionnels, absence d’antécédents, etc.)
- Demander un aménagement de la suspension (permis blanc pour motifs professionnels par exemple)
- Envisager une contestations de l’arrêté préfectoral devant le tribunal administratif
De nombreuses personnes investissent également dans du matériel pratique pour rester dans les clous de la législation, comme un éthylotest électronique homologué, un assistant de conduite GPS avec alerte de vitesse ou encore des accessoires pour une meilleure maîtrise des trajets nocturnes ou par mauvais temps.
En résumé, savoir distinguer les deux types de suspensions permet d’anticiper les conséquences juridiques et administratives, mais permet aussi de mieux gérer sa défense et sa stratégie de récupération de permis. Le recours à des professionnels du droit reste, dans de nombreux cas, un choix judicieux pour préserver ses droits et réduire les impacts négatifs sur la vie personnelle et professionnelle.